|
| 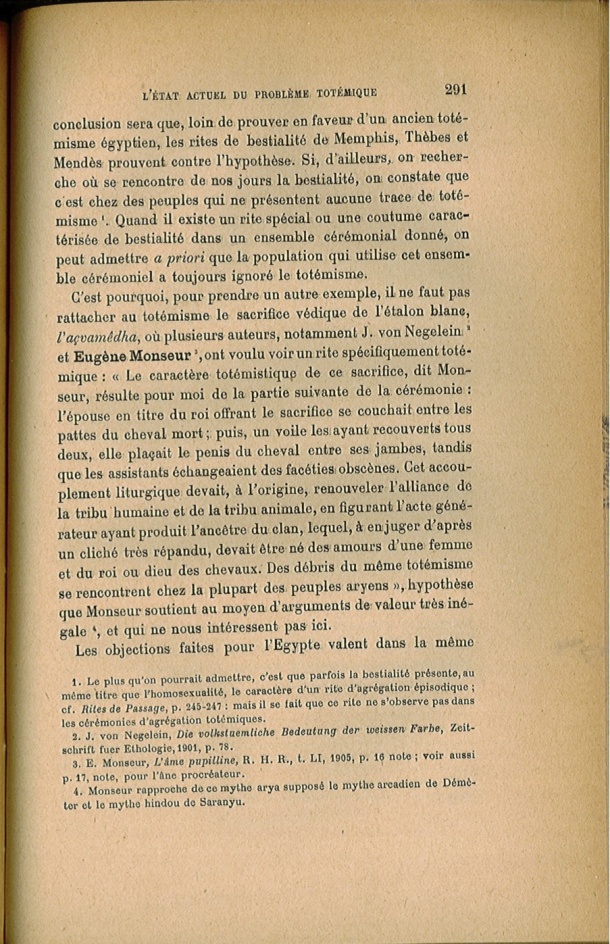
[Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
11km acrutst nu raostrus. rorsnteus 291
conclusion sera que, loin de prouver en faveur d'un. ancien tote-
misme égyptien, les RITEs de bestialité do Memphis, Thèbes et
Btendès prouvent contre l'hypothèse. Si, dailleurs, on recher-
che où se rencontre de nos jours la bestialité, on. constate que
c'est chez des peuples qui ne présentent aucune trace de tote-
misme '. Quand il existe uu RITE spécial ou une coutume carac-
térisée de bestialité dans un ensemble cérémonial donne, on
peut admettre a priori que la population qui utilise cet ensem-
ble eércmoniel a toujours ignore le totémisme.
C'est pourquoi, pour prendre un autre exemple, il ne faut pas
‘ rattacher au totémisme le sacrifice védiquc de l'étalon blanc,
l ïzçuazzzédha, où plusieurs auteurs, notamment Jl. von Negeleintl‘
et Eugène Monseur ’,ont voulu voir un RITE spéeifiquementtoté-
mique: « Le caractère totémistiqup de ce sacrifice, dit Mon»
seur, résulte pour moi de la partie suivante de la cérémonie z
Fèpouso en titre du roi offrant 1c sacrifice se couchait entre les
pattes du cheval mort; puis, un voile lesayant recouverts tous
deux, elle plaçait le peuis du cheval entre ses jambes, taudis
que les assistants cchangsaient des facéties obscènes. Cet aecou«
plement liturgique devait, a l’ origine, renouveler l'alliance de
la trihuliumuiue et de la trihu animale, en figurant: l'acte gène-
rateur ayant produit Pancetre du clan, lequel, a entjuger Æapres
un cliché très répandu, devait etrene des‘ amours dfune femme
et du roi ou dieu des chevaux. Des débris du même totémisme
se rencontrent chez la plupart des peuples aryens mhypothèse
que Monscur soutient au moyen d'arguments le valeur très iné-
gale ‘, et qui ne nous intéressent pas ici.
Les objections faites pour PEgypte valent dans la même
i. Le plus qu'on pourrait admettre, c'est que parfais la bestialité présenta,“
même ‘utrc que Phemosexuslilc, le caractère d'un RITE d'agrégation épisodique;
ci‘. Ritude Passage, p. 245.241 : mais u se mt que ce RITE ne s'observe pas dans
les côrémùnizs Œugrègatmn lotémiques.
2. J. von Negeloin, Dis unthxtnennlichu Bedeutung der weiuewFarbe, ‘Lett-
sclurift fucr nthotogiemnt, p. 1s.
a. e. Menseur, L'âme pupilline, u. H. 1L, t. LI, ma, p. 1e nous; Voir aussi
p. n, note, pour l‘.’tnc procrêalour.
t. Mnnseur rapproche de ce mythe arya suppuae la mythe arcudien de Deme-
ter ct le mythe hindnu de Sarunyu.
|